Programmes du FMI en Afrique
Une idéologie néolibérale survendue et pourfendue
Dans cette nouvelle chronique relative aux rapports entre les Etats africains et le FMI et intitulée « Pourquoi les pays africains doivent-ils arrêter les programmes avec le FMI ?», l’émergentier Cheickna Bounajim Cissé, économiste, essayiste et expert des marchés bancaires africains, aborde la deuxième partie de son analyse consacrée à l’autopsie des programmes du FMI sur le continent. Sans faux-fuyant et avec des éléments factuels, il traite, successivement, de tous les termes qui irradient la polémique autour des politiques de l’institution de Bretton Woods en Afrique : «néolibéral», «austérité», «pauvreté», «croissance», «dette» et «aide».
Le 10 février 2003, Kenneth Rogoff, alors Conseiller économique et directeur du Département des études du Fonds monétaire international (FMI), publia un article au titre martial «La riposte du FMI ». En incipit, il planta le décor : « Vilipendé par les protestataires anti-mondialistes, les politiciens des pays en développement et certains lauréats du prix Nobel de science économique, le Fonds monétaire international est devenu le principal bouc émissaire sur la scène mondiale…comme si ses économistes possédaient le double monopole de l’infamie et de l’erreur. Il est temps de remettre les pendules à l’heure (…). »
Curieux retournement de veste pour ce joueur d’échecs de classe mondiale passé de l’autre côté du tablier ! Après un départ en trombe, l’œil rivé sur le rétroviseur, le chef économiste du FMI tempéra sa riposte : «ces critiques sont, à certains égards, justifiées, même si leurs auteurs (dont moi-même à l’époque où j’étais professeur d’université) tendent à exagérer la gravité des problèmes ; d’autres, par ailleurs, sont sans fondement et ne visent qu’à échauffer les esprits». Il se dit néanmoins consterné de voir le personnel de son institution accusé de néolibéral au point de refuser «d’écouter John Maynard Keynes [même] si celui-ci leur téléphonait d’outre-tombe pour leur donner son avis ».
La fin de l’article est aussi abêtie que son prologue. Pour Kenneth Rogoff, même si les «pays pauvres» décident de se passer de «l’expertise macroéconomique particulière du FMI, il leur faudra bien quelque chose qui y ressemble fort». Le professeur Joseph Tchundjang Pouemi, à la fermeté éprouvée et au raisonnement rigoureux, présentait le Fonds Monétaire International comme la « citadelle du savoir monétaire » ; mais, l’économiste camerounais s’était bien gardé d’affabuler l’institution ounsienne de l’outrecuidance de son homologue américain.
En 1750, face à l’énorme tollé suscité par son ouvrage “De l’esprit des lois”, l’écrivain français Charles Louis de Secondat, alias Montesquieu, prit le parti de la réplique en publiant un autre texte (Défense de l’Esprit des lois), sous la forme d’un droit de réponse. Il y invita ses contempteurs et pourfendeurs à l’observation d’une règle de bon sens : «L’équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l’accusation». A trois siècles de longueur de cette sagesse, notre argumentaire tentera de ne pas s’en démarquer, tout en veillant à observer la rigueur requise à la nécropsie. L’emblématique Premier ministre britannique Winston Churchill disait : «la critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps humain: elle attire l’attention sur ce qui ne va pas ». Il s’agira donc pour nous d’explorer les tenants et de disséquer les déterminants des programmes mis en œuvre par les institutions de Washington en Afrique en donnant la parole à tous les intervenants (laudatifs, dubitatifs et rétifs), à travers au moins six termes qui irradient la polémique : «néolibéral», «austérité», «pauvreté», «croissance», «dette» et «aide».
Consensus de Washington
Entrons dans le vif du sujet. Que recouvre l’idéologie néolibérale ? Dans un article étonnant, presque détonnant, publié dans sa revue Finances & Développement de juin 2016, le FMI nous livre sa propre compréhension du concept : «Le programme néolibéral repose sur deux piliers. Le premier, l’intensification de la concurrence, passe par la déréglementation et l’ouverture des marchés intérieurs, y compris financiers, à la concurrence étrangère. Le second consiste à réduire le rôle de l’État en procédant à des privatisations et en limitant les prérogatives gouvernementales en matière de déficit budgétaire et d’endettement».
Qui décide des programmes des pays africains avec le FMI ? Voici la réponse de l’ancien économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale Joseph Stiglitz : « Les plans, en règle générale, sont dictés de Washington, et mis en forme au cours de brèves missions de hauts responsables : dès leur descente d’avion, ils s’immergent dans les chiffres du ministère des finances et de la banque centrale et, pour le reste, résident confortablement dans les hôtels cinq étoiles de la capitale ».
L’application des programmes d’inspiration néolibérale a-t-elle été bénéfique ou maléfique aux pays africains ? Voici la réponse des services du FMI : « De nombreuses facettes du programme néolibéral méritent d’être saluées. Le développement du commerce mondial a sauvé des millions de personnes du dénuement le plus extrême. L’investissement direct étranger a souvent permis de transférer des technologies et des savoir-faire dans des pays en développement. La privatisation d’entreprises s’est traduite dans bien des cas par une offre de services plus efficace et un allégement de la charge budgétaire ». Certains volets du programme, souligne le Département des études du FMI, n’ont pas donné les résultats attendus : « L’examen [la libéralisation du compte de capital et l’assainissement des finances publiques] aboutit à trois conclusions troublantes :
– les bienfaits en termes de gains de croissance semblent très difficiles à déterminer à l’échelle d’un large groupe de pays ;
– les coûts liés au creusement des inégalités sont importants. Ils témoignent de la nécessité d’arbitrer entre les effets sur la croissance et sur l’équité induits par certains aspects du programme néolibéral ;
– le creusement des inégalités influe à son tour sur le niveau et la durabilité de la croissance. Même si la croissance est l’unique ou le principal objectif du néolibéralisme, les partisans de ce programme doivent rester attentifs aux effets sur la répartition ». Censé assurer la stabilité du système monétaire international, le FMI est taxé d’être une « arme d’expansion du libéralisme et du capitalisme » . Et ce n’est pas totalement faux pour peu qu’on se réfère à son tour de table. Les États-Unis, avec 17,44 % des quotas et 16,51 % des droits de vote, sont le principal contributeur du FMI et disposent de fait d’un droit de véto sur les décisions les plus importantes de l’institution. Lors de son audition au Sénat français, le 21 avril 1999, le haut-fonctionnaire Jean-Pierre Landau, ancien administrateur pour la France au FMI et à la Banque mondiale, déclara : « Le FMI avait donné l’impression, au cours de ses récentes interventions, qu’il était porteur de certaines valeurs, en particulier du modèle économique américain, jugé supérieur, et que ses actions consistaient à l’implanter au tréfonds des sociétés des Etats secourus ».Sans commentaires !
Les politiques trop rigides et contraignantes que le FMI mène en Afrique sont basées pour l’essentiel sur les dix commandements du « Consensus de Washington », ainsi énumérés : discipline budgétaire, redéfinition des priorités en matière de dépenses publiques, réforme fiscale, libéralisation des taux d’intérêt, taux de change compétitif, libéralisation du commerce, libéralisation des investissements directs en provenance de l’étranger, privatisation, déréglementation et droits de propriété.
Ce corpus de préceptes d’idéologie néolibérale a été révélé au public suite à la publication en 1989 d’une note sous la plume de l’économiste et universitaire John Williamson, son concepteur. A y regarder de près, les travaux ayant abouti au « Consensus de Washington » sont fortement inspirés de la vieille théorie de Friedrich Hayek. Cet économiste britannique, lauréat du prix Nobel d’économie en 1974, fut l’un des plus influents défenseurs de l’ultra-libéralisme. L’un de ses plus grands pourfendeurs est Joseph Stiglitz, Nobel d’économie (2001). Dans son ouvrage La Grande Désillusion (2001), cet économiste américain, surnommé le pape du néo-keynésianisme, tira à boulets rouges sur les politiques inspirées par le “Consensus de Washington” : « Dans tous les pays qui les ont appliquées, le développement a été lent, et, là où il y a eu croissance, ses bénéfices n’ont pas été également partagés ; les crises ont été mal gérées. […] Ceux qui ont suivi les prescriptions et subi l’austérité se demandent : quand en verrons-nous les fruits ? ».
En octobre 2013, le professeur Joseph Stiglitz accorda une interview à la Tribune dans laquelle il nous fait accéder à sa hauteur : « La vérité est que la vision d’Hayek, qui stipule que le marché fonctionne parfaitement seul et s’autorégule, était fausse. […] Les fondamentaux de l’économie enseignés dans les universités parlent d’un marché qui se régule de lui-même par l’offre et la demande. Or aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Partout dans le monde, des gens veulent contribuer à la société, veulent travailler, mais ne peuvent pas le faire, ce qui entraîne un gaspillage de ressources. De même, aux États-Unis, des millions d’Américains sont à la rue, alors qu’il y a beaucoup de maisons vides. En réalité, la main invisible censée réguler le marché est invisible… parce qu’elle n’existe pas ».
Dans un article au titre évocateur « Un train de réformes devenu un label galvaudé[13] », publié en septembre 2003 dans le magazine Finances & Développement du FMI, John Williamson remit le couvert en se désolant que son programme de réformes baptisé « Consensus de Washington » puisse devenir « un cri de guerre dans les débats idéologiques ». Il estima que « le terme est devenu si désespérément équivoque qu’il parasite la réflexion. » Il fustigea l’interprétation « populiste » qui est faite de son pack de réformes qualifié par ses détracteurs de néolibéral (« la version la plus à droite d’un programme libéral » à ses dires) avec un « État minimal (qui ne se charge ni de corriger les inégalités de revenu ni d’internaliser les externalités) ». Il indiqua que le « Consensus de Washington » était uniquement destiné à l’Amérique latine en 1989 et ne devrait pas être « une recette valable pour tous les pays et toutes les époques ».
Camisole de force
Mais le hic, ce que John Williamson ne dit pas – et qu’il n’ignore pourtant pas – c’est que sa recette « miracle » est devenue une camisole de force que le Fonds Monétaire International, « temple du monétarisme et de l’orthodoxie néolibérale », a engoncée à tous les États africains sous programme. Quelques que soient leur structuration et leurs mensurations, c’est presque la même ration pour tous.
Avec un brin de persiflage, comment ne pas me rappeler l’histoire de ce papi de mon terroir qui répondit à l’appel sous le drapeau tricolore pendant la colonisation, les pieds nus et les brodequins enlacés au cou. Le colon, boursoufflé à sa vue, jeta un coup d’œil furtif sur ses pieds XXXL (pointure 50 au moins !). Il lui signa, de suite, un certificat de dispense. L’officier recruteur en congédiant ainsi le miraculeux « démobilisé » lui assène néanmoins : « Ce sera pour la prochaine fois ! » C’est vrai qu’à défaut de disposer d’une paire de chaussures à sa taille, il ne lui restait plus qu’à ajuster les pieds du pépère aux godillots. Cette terrible alternative valait aussi dispense au combat. Fermons la parenthèse et poursuivons !
On aurait pu en rester là, si les services internes du Fonds monétaire international (FMI) n’étaient pas aussi montés au créneau pour mettre de l’huile dans les rouages des critiques. Venant d’une institution gardienne de l’orthodoxie financière mondiale, il y a de quoi surprendre les incrédules. « Quand votre chien attrape l’improbable, les bavards et les musards vous feront vivre une journée mémorable », conseillent les sages africains.
En janvier 2013, l’économiste en chef du FMI Olivier Blanchard et un de ses collaborateurs Daniel Leigh, avaient cosigné une étude intitulée « Erreurs de prévisions de croissance et multiplicateurs budgétaires » (traduit de son titre original « Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers »). Dans leur note, les deux économistes reconnaissent vertement « une erreur dans les anticipations des conséquences de la consolidation budgétaire sur la croissance économique. (Et que) les coupes budgétaires ont provoqué un recul plus fort que prévu de la croissance européenne ». En clair, pour eux, « l’utilisation d’un mauvais coefficient de calcul a débouché sur une sous-estimation des effets négatifs de l’austérité en Europe ». Peine perdue pour les décisions politiques prises à dire d’expert ! Alfred Sauvy a peut-être raison : « Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d’être torturés, finissent par avouer tout ce qu’on veut leur faire dire ». Le flegmatique dirigeant politique britannique, non moins prix Nobel de littérature, Winston Churchill est plus acerbe : « Je ne crois jamais une statistique à moins de l’avoir moi-même falsifiée. »
Une pensée néolibérale en berne
Le 26 mai 2016, trois ans après le mea-culpa de Olivier Blanchard, les services études du FMI récidivaient. Trois économistes, Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani et Davide Furceri, respectivement Directeur adjoint, Chef de division et économiste au Département des études du FMI, publiaient dans Finances & Développement, la revue de référence l’institution, un article choc : « Le néolibéralisme est-il surfait ? ». Les auteurs s’interrogeaient sur l’efficacité de certaines recettes « néolibérales » utilisées par leur institution, notamment celles axées sur les politiques d’austérité et l’ouverture du marché des capitaux. Ils indiquaient qu’« au lieu d’apporter la croissance, certaines politiques néolibérales ont creusé les inégalités au détriment d’une expansion durable. » Ils insistaient même sur le coût très élevé des politiques d’austérité. « Depuis 1980, il y a eu environ 150 épisodes d’entrées massives de capitaux dans plus de 50 pays émergents ; (…) dans 20% des cas environ, ces épisodes se soldent par des crises financières liées la plupart du temps à de fortes baisses de la production », soulignaient le trio d’experts du FMI. Pourtant, le professeur Jagdish Bhagwati, spécialiste reconnu des questions d’économie internationale et présenté comme le « gourou de la mondialisation », avait mis en garde le FMI par rapport à son acharnement à promouvoir la liberté des mouvements de capitaux. Dans leur chute, les trois économistes de Washington nous emportaient vers une direction inattendue, tout au moins inespérée : « Les pays et les institutions qui les conseillent, comme le FMI, ne doivent pas être guidés par leurs convictions, mais s’inspirer des recettes qui ont fait leurs preuves ». Voilà qui est dit ! À chacun de s’y mettre ou de se démettre.
Après ses propos acérés, il n’en fallut pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment et que les médias s’entremêlent. La Toile gloutonne d’articles et de commentaires épais et épicés sur le sujet. Il est vrai que cette étude détonnait dans l’univers très fermé du Fonds monétaire international, « cœur battant du consensus de Washington et de l’idéologie dominante », rétif à toute repentance sur ses programmes en Afrique.
Le 2 juin 2016, soit quelques jours après la publication de l’article polémique, le chef économiste du FMI Maurice Obstfeld a tenté de tiédir l’analyse de ses collègues en faisant l’exégèse des propos controversés : « Cet article a été largement mal interprété et il ne faut pas y voir d’inflexion majeure dans la démarche du FMI. Je pense qu’il est fallacieux de poser la question de savoir si le FMI est pour ou contre l’austérité. Personne ne veut d’une austérité stérile. Nous sommes pour les politiques budgétaires qui accompagnent la croissance et l’équité dans la durée. Et ces politiques varient selon les particularités de chaque pays et de chaque situation. (…) C’est là une réalité et non pas une orientation idéologique. » Peine perdue ! Le coup était déjà parti ! Dans sa veine tentative de déminer la polémique, le chef économiste du FMI en a ajouté une couche pour la moins insolite : « Nous avons pour mission de conseiller les gouvernements sur la gestion optimale de leur politique budgétaire, afin d’éviter des conséquences néfastes. Parfois, cela nous amène à reconnaître qu’il est des situations où des coupes budgétaires excessives peuvent aller à l’encontre de la croissance, de l’équité, voire de la viabilité même des finances publiques » avant d’ajouter : « Il y a des limites aux souffrances que les pays peuvent ou doivent endurer. » Sans commentaires !
Il est, aujourd’hui, clairement démontré que la politique néolibérale a été survendue aux pays africains. Bien souvent, il leur a été servi une pâle copie de l’économie de marché. Cette manœuvre inédite et inattendue du FMI, provenant de la profondeur de ses entrailles, avait surpris plus d’un. A quoi rimaient cette prise de conscience soudaine moulée dans la lucidité et l’empathie ? Il est vrai que ces sorties des experts du FMI, décalées par rapport à la doxa, n’étaient certes pas une auto-répudiation, mais elles restaient un amas de « critiques en règle des politiques de dérégulation menées partout dans le monde depuis quarante ans, sous l’égide…du FMI ». Mise en état d’ébullition, la presse en avait fait ses choux gras.
Ne pouvant résister à l’attraction d’une image forte, l’essayiste belge Paul Jorion, professeur de l’université catholique de Lille et ancien enseignant à Cambridge, dira que « l’histoire du FMI, c’est une histoire de désastres successifs. Donc ce n’est pas un organisme qui a une très bonne réputation. Il s’est pratiquement toujours trompé. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas fait de l’analyse mais a suivi un programme idéologique. » Même si la critique est trempée dans le vitriol, elle traduit un mal-être de plus en plus perceptible dans l’opinion publique africaine.
Dans la livraison de mai 2010 de Réalités Industrielles, la très confidentielle revue de l’Ecole des Mines, le doyen des économistes français Maurice Allais, par ailleurs prix Nobel d’économie (1988), fustigea le néolibéralisme en des termes très incisifs : « Le libéralisme ne saurait être un laisser faire ». Pour lui, le chômage, est « la conséquence de la libéralisation inconsidérée du commerce international. » Ancien compagnon de route de Hayek et de Friedman, il reconnut ses propres erreurs du passé et fit son mea-culpa : « Nous avons été conduits à l’abîme par des affirmations économiques constamment répétées, mais non prouvées. Par un matraquage incessant, nous étions mis face à des vérités établies, des tabous indiscutés, des préjugés admis sans discussion. Cette doctrine affirmait comme une vérité scientifique un lien entre l’absence de régulation et une allocation optimale des ressources. Au lieu de vérité il y a eu, au contraire, dans tout ceci, une profonde ignorance et une idéologie simplificatrice. »
Un courant néokeynésien en vogue
Dans cet environnement de clair-obscur, le keynésianisme a le vent en poupe. À coup de milliards de dollars et d’euros, l’Occident fait l’apologie de l’« État providence » – même si on peine à le reconnaître idéologiquement : intervention massive de l’État pour sauver les banques, création de banques publiques d’investissement, protection du marché local et des « champions nationaux », présence de l’État dans le conseil d’administration d’entreprises privées, plafonnement de la rémunération des dirigeants de banques, etc. Bref, tout y passe pour sortir le nez de l’eau. Tout, sauf ce qui est imposé aux pays africains ou que ceux-ci ont choisi – qu’importe d’ailleurs l’un des deux. Et, on n’est pas loin du passage de témoin entre la Chine dite « communiste » qui se privatise, et l’Europe dite « libérale » qui se socialise.
D’énormes sommes sont investies dans les dépenses publiques. Le déficit explose et la dette prend l’ascenseur. Par exemple, le plan Paulson aux États-Unis, du nom de l’ancien secrétaire au Trésor Henry Paulson, avait nécessité la rondelette somme de 700 milliards de dollars, soit 520 milliards d’euros. Ce plan visait à acheter et à gérer certains actifs toxiques des portefeuilles des institutions financières. L’État fédéral américain a utilisé 185 milliards d’euros pour entrer au capital de neuf banques, dont Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America. Si l’on y ajoute les nationalisations des agences de refinancement hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae, de l’assureur AIG, le soutien aux fonds monétaires et les garanties de la Fed au rachat de Bear Stearns, le plan de sauvetage du système financier américain approchait les 1 200 milliards de dollars, soit 8 % du PIB américain.
En Europe, les aides autorisées par la Commission européenne au secteur financier, (il existe 8 000 banques sur le Vieux continent, dont 44 de grande taille), s’étaient élevées au total à 5 059 milliards d’euros (près de trois fois le PIB du continent africain), dont un tiers environ avait été effectivement utilisé (13 % du PIB européen), entre le début de la crise en octobre 2008 et octobre 2012. La majeure partie de ces aides avait été consacrée aux garanties apportées aux banques privées. Le reste a été destiné à leur recapitalisation, à des injections de liquidités et au sauvetage d’actifs dépréciés. En France, le plan de relance au secteur bancaire se chiffrait à environ 400 milliards d’euros, soit 20 % du PIB. Dans la foulée de la gestion post-crise, sans coup férir, le gouvernement français avait créé le 31 décembre 2012 la Banque publique d’investissement (BPI).
Cette débauche exceptionnelle d’énergie des politiques en Occident pour sauver leur système bancaire avait fait dire, ironiquement, au défunt président vénézuélien, Hugo Chavez : « Si le climat était une banque, on l’aurait déjà sauvé. » Le discours n’était certes pas sans arrière-pensées politiques, mais la réalité était crûment déclamée. Dès lors, comment comprendre qu’il puisse être imposé aux pays africains une posture d’« État gendarme », de rester à la périphérie du développement en laissant la main à un secteur privé faible et affaibli, alors que les gouvernants des pays qui en font la médication, signent chez eux sous la pression d’une crise persistante et d’une rue insistante, le grand retour de l’État dans les affaires ?
L’économiste Paul Krugman, Prix Nobel d’économie 2008, lançait un pavé dans la mare : « Le FMI était moins enthousiaste vis-à-vis de l’austérité que les autres grands acteurs. Si lui-même dit qu’il s’est trompé, cela signifie que tous les autres […] se sont encore plus trompés. »
Vous voilà avertis chers dirigeants africains ! Quand le médecin reconnait lui-même qu’il a pu se tromper de prescription, que reste-t-il finalement au malade, qui tient comme par extraordinaire sa santé en bandoulière, depuis près de quatre décennies, déambulant entre aumôniers en petite forme et braconniers de grand chemin ?



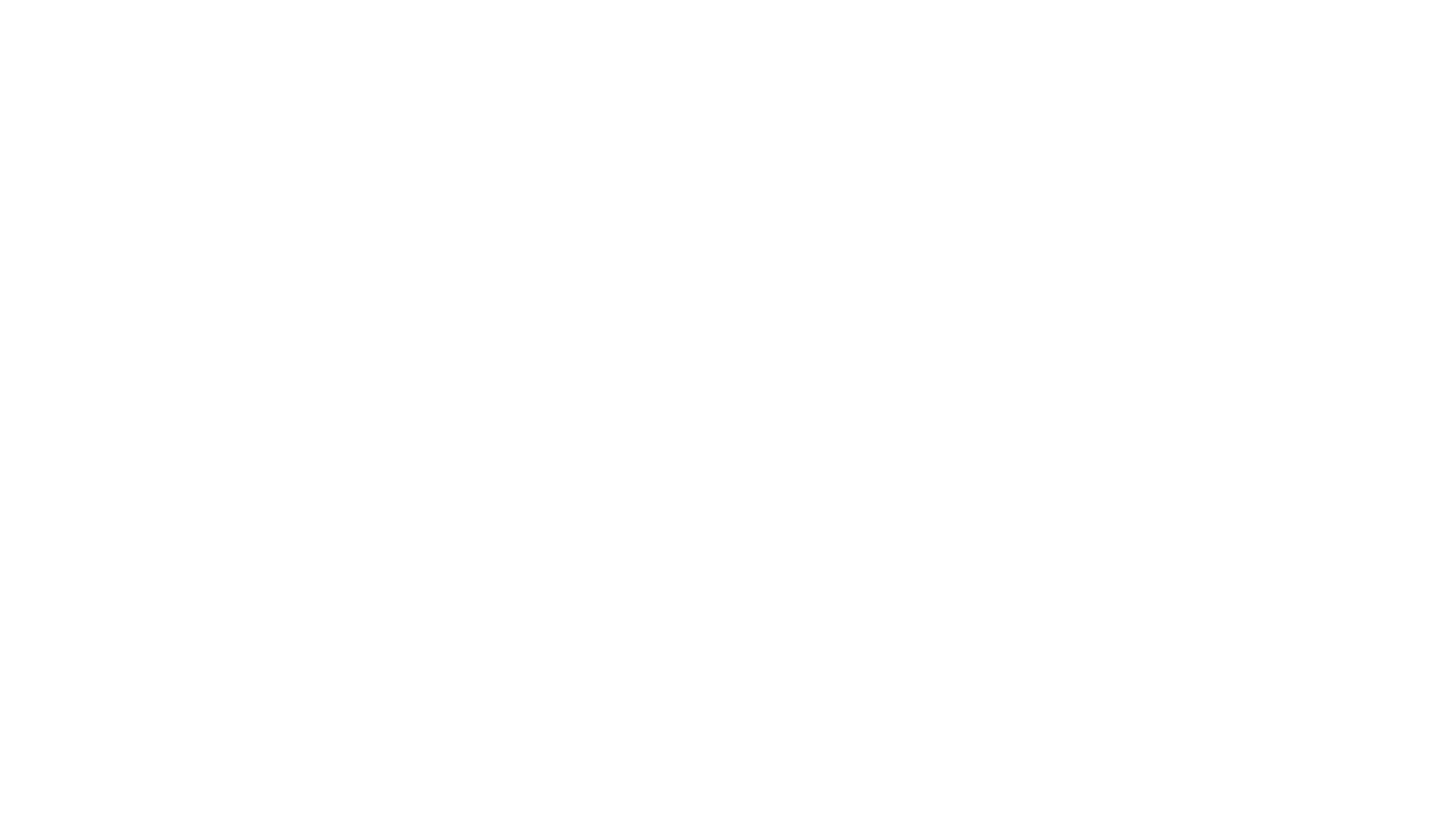
Average Rating